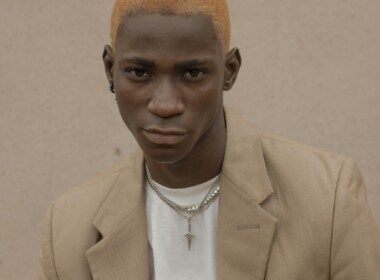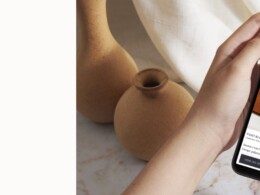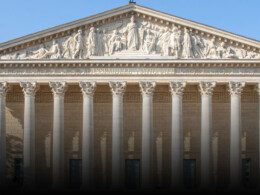Trous béants pour creuser des mines de diamants, exploitation humaine et utilisation de produits chimiques, notamment pour l’extraction de l’or… La production des matériaux traditionnellement utilisés dans la joaillerie pèse sur l’environnement. Certains joailliers décident de se détourner des productions traditionnelles et d’utiliser des matériaux alternatifs, plus responsables et surtout tout autant beaux et durables. Tour des possibilités.
Chaque année, près de 90 millions de carats de diamants bruts et 1 600 tonnes d’or sont extraits pour l’industrie de la bijouterie. Une activité qui fait vivre environ 150 millions de personnes à travers le monde et génère plus de 300 milliards de dollars de revenus annuels. Si ces matériaux symbolisent luxe et prestige, les réalités de leur extraction font bien moins envie. Métaux précieux et pierres précieuses… Ces matières premières qui composent nos bijoux proviennent de mines dont l’exploitation a un coût environnemental et humain considérable. L’usage du mercure, les conditions de travail souvent difficiles, et dans certains cas, ces mines sont le théâtre d’exploitation infantile ou de travail forcé. En Afrique notamment, certaines sont étroitement liées aux groupes armés locaux et contribuent à leur financement.
La circularité des pierres et des métaux précieux
Que ce soit l’or mais aussi le cuivre, le bronze, l’acier inoxydable, l’argent, le néodyme ou encore le tungstène, ces métaux peuvent être recyclés et durer dans le temps. Une poignée de joailliers proposent des bijoux à partir de métaux recyclés provenant de pièces déjà existantes ou de matériels informatiques. C’est le cas d’Emmanuelle d’Ortoli. “Je ne vais pas acheter de l’or chez un grossiste puis le recycler. Je vais vraiment essayer d’aller le récupérer à partir d’anciens bijoux, que ce soit de vente aux enchères ou de nos clients, pour réaliser une collection. Quand ce sont des demandes sur mesure, je peux aussi transformer l’or des bijoux qu’on me ramène.”.

Le recyclage de l’or
Bon point, l’or se recycle à l’infini sans perdre ni matière, ni qualité. Selon le report Mine secondaire et recyclage de 2024 de l’association SystExt, la production secondaire d’or – principalement à base de déchets de haute valeur comme les bijoux, de pièces de monnaie ou de lingots – est en constante augmentation mais reste minoritaire par rapport à l’offre primaire, provenant de l’extraction. “En 2021, elle représentait un quart de la production mondiale d’or”. Néanmoins, nous continuons encore d’en extraire.
L’or est également de plus en plus difficile à récupérer sur les déchets industriels, ajoute l’association. Le métal est de moins en moins présent dans les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) et “la part des déchets valorisables est faible : en 2025, seulement 2 % de tous les DEEE devraient être concernés“.

Le choix d’un label pour certifier une production plus éthique de l’or
Quand la quantité d’or recyclé disponible n’est plus suffisante face à la demande, il est aussi possible de se tourner vers l’or vierge dont les conditions d’extraction sont mieux encadrées. Pour Emmanuelle d’Ortoli, c’est une approche à considérer. “Notre priorité est d’utiliser le matériel à notre disposition, mais si on augmente encore notre production, on va s’y tourner car il fait vivre plus de gens que l’extraction industrielle“.
La joaillerie JEM s’est entièrement tournée vers cette option avec un or certifié Fairmined. Ce label, créé par l’ONG Alliance pour une Mine Responsable (ARM), garantit un Or vierge d’exploitation humaine et traçable, de son extraction au bijou final. Il atteste de la provenance du métal produit par des mines artisanales, à petite échelle et assure le développement social et la protection de l’environnement. “Notre objectif c’est de transformer les pratiques. Aujourd’hui, il n’y a que 10 000 mines certifiées Fairmined, c’est tout petit par rapport à l’extraction d’or. Donc on a vraiment un rôle de transformation de la filière lorsqu’on choisit cet or-là“. raconte Dorothée Contour, fondatrice de la marque.

“C’est vraiment important de participer à la transformation des pratiques minières, parce qu’il y a des dégâts qu’on ne peut pas ignorer. 50 % de l’extraction minière de l’or part en joaillerie et nous on pense qu’on peut être un moteur. C’est même notre devoir“
Les perles : prendre la responsabilité de la sauvegarde des océans
La joaillerie JEM a choisi de travailler avec une petite ferme perlière, située dans l’archipel des Fidji et développée par un biologiste marin fidjien et américain, Justin Hunter. Il utilise le développement local de cette filière pour développer des programmes de protection des océans, comme l’interdiction de la pêche au cyanure, le contrôle de la pollution des bateaux et la protection des coraux. Dorothée Contour explique pourquoi elle a été séduite par le projet Blue Circular Economy. “Pour nous c’est une démarche intéressante car on est dans une démarche positive où tout le monde y gagne. Grâce à la perle, on va plus facilement pousser les communautés locales à protéger les océans. Derrière le bijou, il y a nos actions mais aussi le discours qui sensibilise nos clients sur ces sujets de société.“
Les diamants de synthèse : un marché qui gagne du terrain
En plus de leur impact environnemental conséquent, les diamants de mine ont souvent été qualifiés de “diamants de sang” car leur extraction alimente la violence dans certains pays d’Afrique. Aujourd’hui encore, les joailliers utilisent des diamants naturels dans leur création, tout en s’assurant de leur provenance grâce à des labels. Emmanuelle d’Ortoli fait appel à des fournisseur·ses de diamants et de gemmes qui suivent les accords de Kimberley, “ce sont des accords entre tous les acteur·rices de la chaîne de diamants qui garantissent que les profits générés ces diamants ne vont pas servir à financer des guerres ou des combats“.
Un coût environnemental moindre, pour une même qualité
Avancé comme un argument marketing pour leurs fabricant·es, les diamants fabriqués en laboratoire s’imposent alors comme une véritable alternative éthique. Mais l’est-il réellement ? Si la production demande énormément d’énergie, “le travail réalisé en laboratoire se fait dans de bonnes conditions”, souligne Manuel Mallen. À la tête de la joaillerie Courbet, située place Vendôme, celle-ci est la première à lancer le mouvement des diamants réalisés en laboratoire en France, depuis 2018.
Malgré ce besoin d’énergie, le coût environnemental est incomparable selon Mallen. “Un carat c’est 0,2 gramme on va jusqu’à extraire 250 tonnes de minerais pour le trouver”. Côté prix, la différence est aussi frappante. Pour un diamant de 4 carats, comptez 200 mille euros s’il est naturel, un prix qui augmente de manière exponentielle. Lors d’une production en culture, le coût est linéaire : comptez entre 18 et 20 mille euros, explique-t-il.

Pourtant, les deux types se ressemblent en tout point : la même beauté, à la différence qu’une création en laboratoire pourra proposer des formes plus originales lors de la taille. Le fondateur de Courbet affirme : “C’est vraiment la même chose, c’est un diamant ! La pierre s’est formée par une réaction physique chimique. Le carbone sous haute pression de température se cristallise comme dans la nature et il devient du diamant. C’est une autre naissance du diamant, tout simplement“.
Manuel Mallen privilégie l’importation depuis les Etats-Unis à la Chine, pour leurs ressources solaires et nucléaires, et s’intéresse à l’Inde lorsqu’il sera assuré de leur production d’énergies vertes. “Et demain en Europe“, espère-t-il dans l’attente de l’aboutissement d’un projet dans le Sud de l’Espagne avec l’entreprise américaine Diamond Foundry.
Une démocratisation encore difficile
Pour Mullen, les pays européens sont en retard. “70 % des détaillant·es américain·es proposent les deux types de diamants. Depuis juillet 2024, la quantité de diamants de laboratoire a dépassée celle des diamants de mine”. Les grandes marques, notamment françaises et italiennes, sont encore réticentes, avoue-t-il. Il pointe notamment du doigt les lobbies du diamant. Il met aussi en cause l’appellation du produit. Légalement nommée “diamant de synthèse ou synthétique”, Mullen préférerait “de culture” ou “fait en laboratoire”, une dénomination plus juste. “La France est le dernier pays à l’appeler diamant de synthèse, c’est pour vous dire à quel point le lobby est fort“
Enfin, le joaillier tient à contredire des idées préconçues sur les diamants de mine. “Le premier grand fantasme du diamant de mine c’est d’avoir fait croire aux gens qu’il était rare. Or on a extrait des milliards de carats des mines, il y en a partout. Le deuxième gros mensonge c’est la valeur d’investissement d’un diamant. Sa valeur de revente n’est pas bonne, sauf s’il est très rare ou s’il a une histoire particulière.” Alors comment justifier ces prix ? “Le marché du diamant de mine est contrôlé par De Beers depuis 70 ans“, explique-t-il, “Il maîtrise les mines, les stocks, les investisseur·ses et les prix. Alors que le marché du diamant de laboratoire se régule en fonction de l’offre et de la demande“.