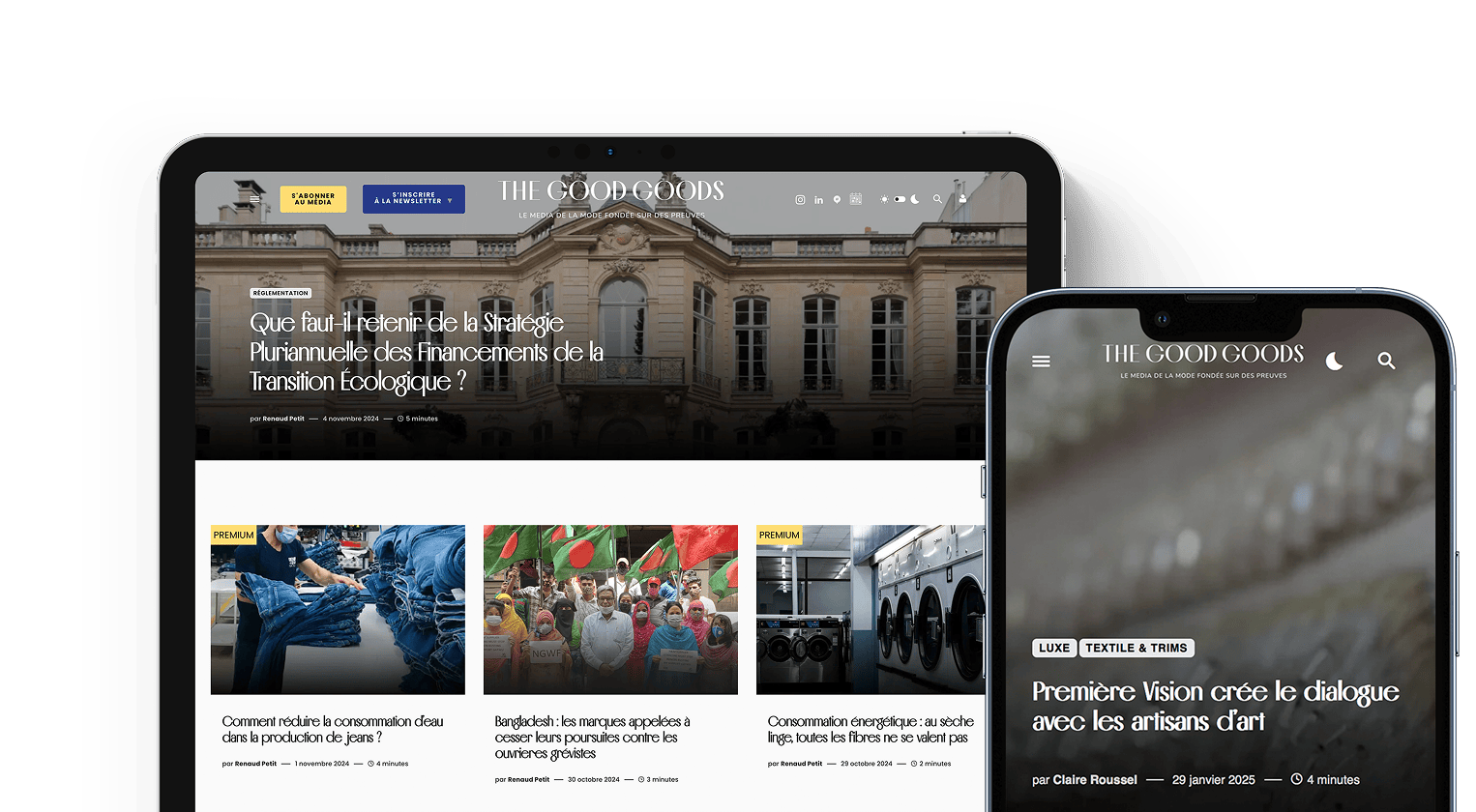Souvent présenté comme un pan écoresponsable de la mode, la fripe recouvre une économie fragmentée, mondialisée et pas toujours éthique. C’est ce qu’analyse l’anthropologue Emmanuelle Durand dans L’Envers des fripes (Premier Parallèle), fruit de cinq ans d'enquête ethnographique de terrain. Cet ouvrage donne la parole aux travailleurs de la seconde main, des centres de tri belges aux entrepôts de grossistes de Beyrouth. Refusant d’encenser ou de condamner cette filière, il restitue la complexité d’une économie en mutation et ses implications sociales, politiques et historiques. Entretien avec la chercheuse sur ces enjeux méconnus.
Votre ouvrage souligne un aspect encore peu documenté de la seconde main : son caractère ultra mondialisé. Pourquoi avez-vous choisi cette approche ?
Emmanuelle Durand : Mes recherches portent sur les dynamiques commerciales à partir d’une socio-anthropologie du travail. En démarrant ma thèse, j’ai choisi de me concentrer sur un objet : le vêtement usagé. En tant que matérialité au statut changeant (de rebut, il redevient marchandise désirable), la fripe relève à la fois des déchets et de la mode, deux bouts opposés de la valeur qui sont tous les deux assez méprisés car vus comme dévalorisant ou superficiel. Pour montrer ses implications sociales, économiques et politiques, je me suis intéressée aux circulations spatiales de cette catégorie de textile, mais aussi aux mains entre lesquelles elle passe.

D’après vos recherches, la fripe permet à la mode de surproduire sans sanctions économiques…
La fripe est un sujet faussement simple qui est unilatéralement présenté comme “alternatif”. Ses filières sont multiples et les modèles variés. Il existe des initiatives locales de dépôt-vente, parfois associatives, qui méritent d’être défendues. Avec le temps, la fripe s’est énormément complexifiée, on constate une diversification des acteurs : associations, boutiques privées, plateformes digitales, enseignes multinationales… Par ailleurs, de plus en plus de vêtements neufs irriguent certaines filières à cause de la surproduction, mais aussi des effets pervers de la loi AGEC : une loi avec de bonnes intentions de départ qui interdit la destruction des invendus. Elle invite - et même incite par une défiscalisation - les professionnels à donner leurs invendus aux associations (ainsi, 20% des invendus des marques y terminent d’après l’ADEME). Mais sur le terrain, certains “dons” sont en réalité invendables : ils ont été stockés dans des entrepôts humides, sont mal calibrés, de mauvaise qualité… Ainsi, la filière de la seconde main offre aux marchandises surnuméraires et défectueuses de l’industrie textile une voie de sortie : un marché. Cela autorise la fast fashion à se décharger de ses stocks - sans craindre d’être étouffée - et ainsi de poursuivre son rythme effréné de surproduction.

DEVENEZ MEMBRE
- Tarifs réduits > 2 personnes
- Accès à tous nos contenus
- OnePagers à télécharger
- Tarifs préférentiels sur Masterclass & Conférences